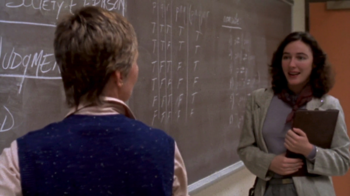John Sayles
Du 20 octobre au 13 novembre 2021
John Sayles, la carte et le territoire
« En matière d'intégration, ce qui est important si vous voulez être un tant soit peu sérieux avec tout cette connerie de rêve américain, avec tout ce simulacre de démocratie, c'est d'inclure autant d'Américains que possible dans l'équation. » (John Sayles)
À quelques détails près, la carrière de John Sayles aurait pu ressembler au parcours exemplaire d'un cinéaste commercial : comme Coppola et Scorsese, il fait ses armes auprès du roi de la série B, Roger Corman, rédige la première mouture de ce qui deviendra E.T. L'extraterrestre, devient un script doctor sollicité par les grands studios hollywoodiens. Mais les histoires qui habitent Sayles ne pouvaient faire de lui, définitivement, qu'un maverick (très content de l'être) : ses dix-huit longs métrages forment une contre-histoire de l'Amérique qui ne pouvait s'épanouir qu'à l'intérieur d'un système de production totalement indépendant – qu'il finance, façon Cassavetes, grâce à son métier d'ouvrier de l'ombre dans le cinéma mainstream.
L'œuvre de Sayles, littéraire et cinématographique, recouvre de nombreux genres, comme si chaque récit devait trouver la forme (et l'État américain) qui lui est propre : western (Texas), mélodrame (Louisiane), film sportif (Illinois), science-fiction (New York), teen movie (New Jersey), « robinsonnade » (Alaska), road movie (frontière mexicaine), fiction politique (Colorado), film choral (Floride) et historique (Virginie-Occidentale)... Et en même temps, le cinéaste casse cette formule des genres pour mieux faire surgir une constante, fil rouge de toute son œuvre : à l'échelle d'une communauté, d'une ville, d'un groupe d'amis ou d'une relation amoureuse, la réalité américaine s'avère structurée par les rapports de classe, ce grand secret (« the big american secret » comme lui dit un jour une journaliste) savamment dissimulé par les récits officiels. Dès lors, le cinéma façon Sayles, médium critique, saura se placer au confluent de plusieurs disciplines : la littérature, l'ethnographie, la sociologie, l'histoire et les sciences politiques.
Un cinéaste débordé
C'est avec 30.000 dollars en poche qu'il réalise son premier film, Return of the Secaucus 7, portrait d'une bande d'amis qui se retrouve le temps d'un week-end. L'occasion d'un bilan collectif, autant intime que politique. Entre intrigues amoureuses et désillusions, ce chef-d'œuvre du « film de copains » (New Hampshire) s'affirme comme un manifeste pour l'œuvre à venir : une manière de mêler organiquement fiction et politique, qui donnent l'impression de se faire un mutuel bouche à bouche, comme lors de cette partie de Cluedo où les femmes du groupe discutent, tout en jouant, de l'ignorance dans laquelle sont tenues les Américaines en matière d'éducation sexuelle.
Déjà, la caméra ne se suffit pas d'un personnage, d'une trajectoire, mais cherche avidement à adopter tous les points de vue. À l'intérieur même d'un plan, elle glisse, se distrait, essaie de tout consigner, avec une idée fixe en tête : que chaque personnage ait le temps de raconter son histoire. Le plan devient sanctuaire, abri, le temple d'une écoute obstinée mais débordée ; c'est qu'elle doit faire le tour des personnages, d'un lieu, d'une ville et, à l'échelle de l'œuvre entière, d'un continent. Un principe qui guidera tous ses films, et plus particulièrement ses œuvres chorales : Sunshine State, City of Hope, Silver City, autant de portraits en coupe d'une ville et de ses habitants qui rappellent les grands films-peuple de Robert Altman et annoncent les descriptions sociologiques et balzaciennes du showrunner David Simon (The Wire, Show Me a Hero).
« Le monde entier n'est qu'un immense syndicat »
Une seule histoire ne suffit ni à faire fiction, ni à dire toute la vérité – le un, c'est la mort. Alors, le film choral devient une nécessité esthétique et politique, qui évite de tomber dans la fétichisation d'un point de vue, d'une trajectoire, d'un grand récit unificateur venu d'en haut et que tous devraient adopter. Et quand il n'y a qu'un héros, alors celui-ci est un observateur, alter ego du cinéaste, en immersion : dans The Brother, film devenu culte aux États-Unis, le spectateur suit la trajectoire d'un extraterrestre noir et muet qui débarque à Harlem en passant par Ellis Island. Il se promène, écoute, regarde, imite et enregistre tel un enfant-ethnographe. Sa trajectoire ressemble à une fable sur l'esclavage et l'assimilation, et prouve superbement que Sayles parvient toujours à tenir ce fragile équilibre entre souffle fictionnel et didactisme.
Sous la carte du cinéma américain, le cinéaste cherche à épouser la forme du territoire et y trouve, toujours, une réalité américaine conflictuelle qu'un excès de storytelling béat est parvenu à étouffer. Ses films réitèrent sa vision d'un peuple fondamentalement divisé en communautés ethniques et groupes de pression qui se regardent en chiens de faïence, en classes sociales aux intérêts divergents, orphelins d'un illusoire armistice. À plusieurs reprises, les films organisent de splendides face à face entre deux personnages issus d'une même communauté ethnique mais qui n'appartiennent pas à la même classe sociale, et parfois l'inverse. Dès lors, sont-ils alliés ou ennemis ? Une manière de rendre brûlant à même l'image ce conflit de loyauté, déterminant et irrésolu, traité nulle part dans le cinéma officiel, entre classe et race.
« Je sais comment fabriquer une histoire plus populaire. Mais alors, ça devient des conneries. »
Cette lucidité historique qui l'habite est, forcément, un travail à même les codes de la fiction puisqu'elle empêche que se libèrent les endorphines aveuglantes du happy end. Le film sportif est ainsi dépourvu de sa conclusion triomphaliste (Les Coulisses de l'exploit), la romance du teen movie est décimée par le fossé social (Baby, It's You), l'émancipation féminine se gagne au prix d'un grand chagrin d'amour (Lianna). Le cinéaste ne succombe jamais aux sirènes de la fiction réparatrice, et cette lucidité mâtinée de pessimisme culminera dans son chef-d'œuvre : Matewan, réalisé en pleine ère reaganienne, l'histoire vraie d'une communauté de mineurs qui, en 1920, s'organise en syndicat pour protester contre la baisse du prix du charbon. Chapitre sanglant et oublié des luttes ouvrières américaines, Matewan inscrit John Sayles dans le sillage d'un Howard Zinn, historien marxiste du grand récit américain conté comme une sempiternelle lutte à armes inégales et qui épouse le point de vue des « lapins » et non plus des « chasseurs ».
Tant qu'il y a encore des histoires, semblent nous dire ses films, il n'y aura pas de fin de l'Histoire. Pour survivre, il faut donc, inlassablement, continuer à en raconter : des légendes (Passion Fish), des contes fantastiques (Le Secret de Roan Inish), ou un passé fait de luttes et d'oppressions bien réelles et que l'on fait circuler en contrebande. Le motif est tellement omniprésent qu'il dresse une solidarité secrète entre tous les films, entre les personnages, entre les vivants et les morts. Être fidèle au passé consiste à se faire le digne continuateur d'une lutte des classes immémoriale, à relancer comme une balle la conflictualité, seule chose dont on hérite vraiment aux États-Unis.
« Il y a un politicien en chacun de nous »
Cette lutte prend la forme d'un western réactualisé, toujours marxiste : des promoteurs immobiliers sans foi ni loi, qui rêvent d'exproprier les habitants d'une ville pour faire sortir de terre hôtels de luxe, centres commerciaux et terrains de golf – ces derniers figurent l'image même d'un récit aplani, faussement pacifié, au profit des vainqueurs. Une gentrification galopante qui devrait figurer le terminus de toutes les revendications politiques mais dont l'extension est enrayée par la découverte d'une histoire plus vieille que les vivants et leurs ambitions, et qui en impose : par exemple, l'exhumation d'un cimetière indien (Sunshine State). Dans Silver City, l'ascension d'un politicien corrompu est interrompue par la découverte d'un cadavre repêché dans un lac. Lorsqu'il n'y a plus aucun recours sur la terre ferme, Sayles fait appel aux profondeurs, aux fictions enfouies sous l'eau et la terre, dans un rapport quasi mystique aux éléments.
Dans Limbo, une femme, son nouveau compagnon et sa fille échouent sur une île reculée d'Alaska. L'adolescente a retrouvé, caché dans les plis d'un abri de fortune, le journal intime d'une habitante de l'île abandonné là. Chaque soir, un rituel se met en place et qui aide le trio à survivre : au coin du feu, l'homme et la femme écoutent la jeune fille lire quelques pages de ce récit retrouvé. Un soir, la mère ouvre le journal et se rend compte qu'il est majoritairement composé de pages blanches. Sa fille a tout inventé, mais le soir même, sans rien dire, la mère l'écoute religieusement. « Everybody is a politician » entend-t-on dans un autre film, et si toute l'œuvre de Sayles figure des héros conscients de leur place, de leur classe et de leur lutte, il y a un moment, presque sacré, où l'on peut – un temps – baisser la garde. Sur une île, dans un cimetière, près de la mer ou d'un feu, là où se cachent les histoires oubliées et peut-être fausses, magiques et minuscules, on peut de nouveau croire à tout ce qu'on nous raconte.
Murielle Joudet